treize juillet deux mille vingt-trois
La prise d’armes de la Légion étrangère au jardin du Luxembourg, comme tous les 13 juillet, semble-t-il, me donne l’occasion de réfléchir au sentiment national qui anime Daphné. Des choses simples, j’entends, comme, par exemple, son goût pour l’hymne, son envie de voir le défilé demain, des choses simples qui se nouent avec sa passion pour l’histoire de France (et l’histoire du monde en général). Pourtant, nous ne sommes pas exactement nationalistes, Nelly et moi. Pour partie, en effet, nous sommes français un peu par hasard, mais il me semble néanmoins que ce sentiment qui anime Daphné est le fruit d’une socialisation réussie : l’apprentissage la langue, quelques notions civiques et une connaissance honnête de l’histoire de France doivent donner lieu à une forme simple, non excessive, non pathologique, puisque c’est de cela qu’il me semble qu’il s’agit, d’amour de son pays. Que cet amour non pathologique de son pays (« non pathologique » i. e. qui ne s’accompagne d’aucune haine de l’étranger ni d’aucun autre pays) soit très fréquemment tenu pour problématique en dit long sur l’état de notre pays, l’état moral, si j’ose dire, et la haine de soi qui, en réalité, anime une grande partie de sa vie publique. Au fond, que dit le sentiment national qui s’exprime en soi sinon que nous ne sommes pas les premiers sur terre et que si nous parlons la langue que nous parlons, si nous avons les coutumes que nous avons, c’est parce que nous ne sommes pas les premiers à parler cette langue que nous parlons, ni les premiers à avoir les coutumes que nous avons ? On me rétorquera que les temps changent. Mais, le plaisir de se vautrer dans le trivial d’une remarque mis à part, on ne voit pas très bien quelle pourrait être sa pertinence. Je passe un temps beaucoup trop long à chercher une citation que je n’avais pas jugé bon de noter (une de mes nombreuses mauvaises habitudes) dans le livre de Samuel Brussell, Continent’Italia. Je ne la trouve pas là où je pensais qu’elle se trouvait et puis, ayant recours à des expédients peu avouables pour la localiser, je me rends compte qu’elle était bien là où je l’avais tout d’abord cherchée sans la trouver. La voici : « pour être libres, il nous faut voir un monde varié, toujours à découvrir, avec des frontières et des limites. » Qu’un écrivain qu’on dit volontiers « cosmopolite » (adjectif qui, pour ma part, me déplaît à cause des sous-entendus qu’il évoque) défende l’idée selon laquelle les frontières sont nécessaires à la liberté, à la diversité, voilà qui a de quoi surprendre tant il est vrai que, pour la morale commune des mieux pensants de nos contemporains, l’absence de frontières semble être une condition sine qua non du règne du bien sur terre. Or, il est probable qu’il n’en soit rien et que la fongibilité universelle des personnes qu’implique le fantasme d’une rotondité ininterrompue soit l’un des grands maux de notre temps, comme si une version cool de la vision auschwitzienne du monde s’était imposée partout avec l’approbation de peuples dépossédés d’eux-mêmes. Je ne suis pas certain de croire mot à mot à ce que je dis : mon idée, si c’en est une, en tout cas, n’est pas d’assigner qui que ce soit à résidence, mais de trouver des moyens permettant de mettre un terme à la dépossession du sens dont, depuis Auschwitz, donc, nous sommes victimes. Parce que notre époque, faute d’avoir redécouvert, une fois le choc passé, ce que cela faisait d’être humain, est toujours celle d’Auschwitz.
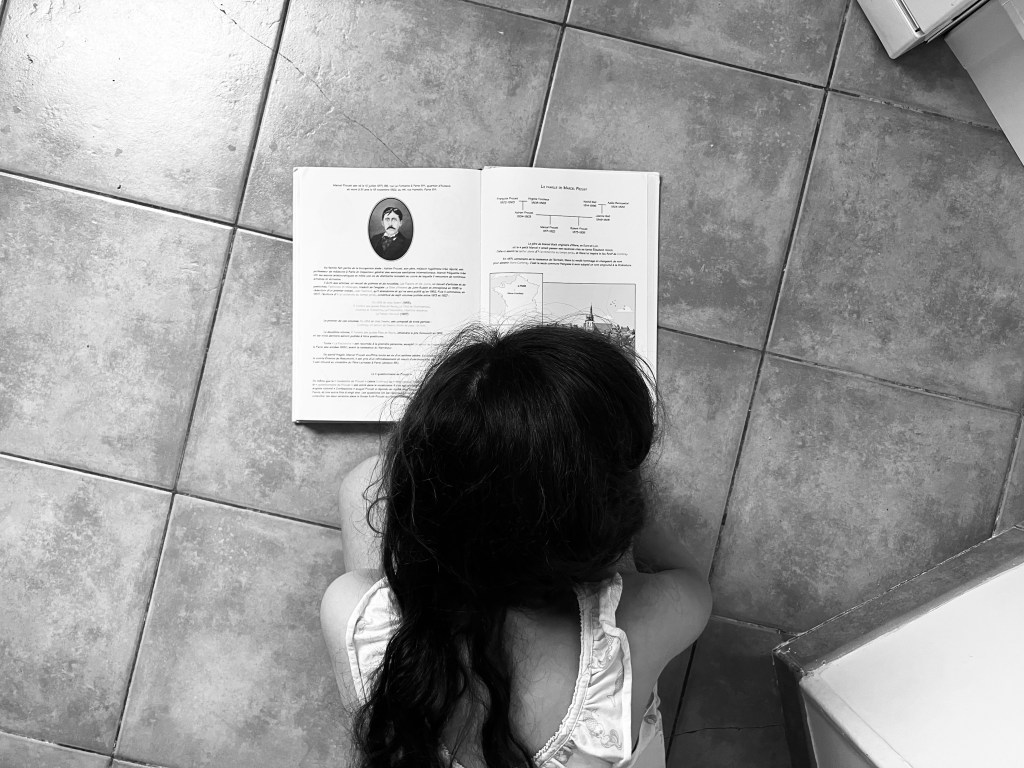
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.