J’ai toujours été italien sans jamais l’être. Ou l’inverse, comment savoir ? Ma grand-mère l’était, de nationalité italienne, qui a émigré de son Piémont natal pour venir en France, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, où elle a épousé mon grand-père Étienne, le Communiste, le père de ma mère. Ma mère parlait couramment italien, sa langue maternelle à elle, contrairement à moi, qu’elle a étudiée à l’université. Parfois, à la maison, elle décrochait le téléphone et, pendant ce qui me semblait être des heures, dans cette langue belle et banale à la fois, elle parlait à un interlocuteur que je n’entendais pas, une cousine ou un cousin restés au pays que je n’ai plus vus depuis des années, et qui sont morts, peut-être, comme ma mère. Ne pas vivre dans un seul idiome, être d’ici et être de là-bas, en même temps, ce n’était pas quelque chose à quoi je pensais, que je me représentais comme une spécificité, un particularisme, ou je ne sais quoi d’autre, c’était la réalité, pure et simple, comme l’accent à couper au couteau de ma grand-mère Madeleine, cet accent que je trouvais parfaitement normal, parfaitement français, c’est-à-dire que je ne l’entendais même pas, qu’il n’était pas un accent pour moi, pour moi, ce n’était rien, que la voix de ma grand-mère. Que je n’aie jamais vécu cette réalité comme singulière, comme étrange, ni comme une chance, ni comme un fait, ni comme rien du tout, en réalité, mais qu’elle se soit toujours présentée à moi comme la seule façon de vivre possible puisque c’était celle que je vivais, cela a profondément marqué, je crois, ma manière de penser, de voir le monde, comme on dit, de sentir. La vie est plus large quand on l’entend dans plusieurs langues, quand on peut voyager, ne serait-ce que par l’écoute, passer d’un monde à l’autre, quand on peut se sentir aussi bien d’ici que de là-bas, sans qu’entre ici et là-bas, il n’y ait de réelle opposition, de réelle différence, de réelle distinction. J’étais trop français pour vivre le rejet dont ma grand-mère et nos compatriotes ont pu faire l’objet en venant vivre ici et je n’étais pas assez français, pas plus que je ne le suis devenu avec le temps, pour m’en soucier. Je n’ai jamais appris à parler italien, c’est sans doute un grand tort, mais je n’en ai jamais ressenti le besoin. Dire que je le parle mal, dès lors, c’est un euphémisme. En tout cas, je le parlais mieux quand, enfant, nous allions passer les vacances en Italie : un été, je me fis un ami qui ne parlait pas un traître mot de français, lui, ses grands-parents n’avaient pas émigré, eux, mais avec qui il ne me sembla pas qu’il y eut jamais le moindre problème de compréhension. En fait, tout semblait couler de source, de sa bouche jusqu’à mes oreilles, et réciproquement. Tout était naturel. Et cette nature était belle, et elle était simple, et elle était ordinaire. Peut-on imaginer une autre nature ? Je me souviens que, pendant des heures, cet été-là, cependant que nous marchions dans la région de Madonna di Campiglio, je comptais en italien, de uno jusqu’à tant que je pouvais, sous le contrôle de ma mère, à qui je demandais, à intervalles réguliers, de confirmer que je ne me trompais pas. À présent que j’ai une fille qui, elle non plus, parfois, ne peut pas s’arrêter de parler, je comprends ce que j’ai fait subir à ma mère, et j’imagine aussi la joie que, peut-être, j’ai pu lui procurer. Mais laissons cela : ce ne sont pas des mémoires que je veux écrire. Le genre ni la chose ne me passionnent. Je n’ai rien vécu d’assez intéressant pour le raconter. Et je suis encore un peu trop jeune pour me mettre à radoter. Qu’est-ce que je veux dire alors ? Peut-être, ceci : le voyage, j’en suis convaincu, le voyage n’est pas simplement physique. Il y a tout ce qui l’entoure, tout ce qui le prépare, tout ce qui a lieu sans déplacement, tout ce qui, en lui, est statique. Mais aussi toute la mémoire, tout le passé qui le précède, l’accompagne, l’anticipe, toutes ces choses que je vois sans les yeux, que j’entends sans les oreilles, toute la vie souterraine, sourde, trop souvent, tout cette vie qui ne demande qu’à sourdre, passer à l’expression, sortir de la marge où la vie normale la repousse, la bloque, l’étouffe. Je ne cherche pas à résumer, à rassembler en un trait ni en une formule un ensemble si disparate d’émotions, de pensées, de sensations, de souvenirs, d’images qu’il ne mérite probablement pas ce nom d’ensemble. Je veux tout laisser en l’état, non pas de fragments, ce n’est le mot qui convient, mais à la manière d’une rhapsodie qui s’interdit de céder à la tentation prétentieuse et étriquée — toute prétention est étriquée — de définir. Pour ne pas arrêter les choses. Ainsi, ce qu’est l’Italie, pour moi ou pour n’importe qui, je n’en sais rien. Et je ne crois pas que, quand même je le saurais, il serait très pertinent que je le dise. Tout ce que je peux confesser, dans une manière de géographie négative, c’est que l’Italie n’est pas simplement le nom d’un pays ni, pour tout dire, donc, simplement ce pays nommé. Et, renversant cette géographie négative par la grâce d’une palinodie instantanée, dire enfin ceci : l’Italie, c’est le pôle sud de la vie.
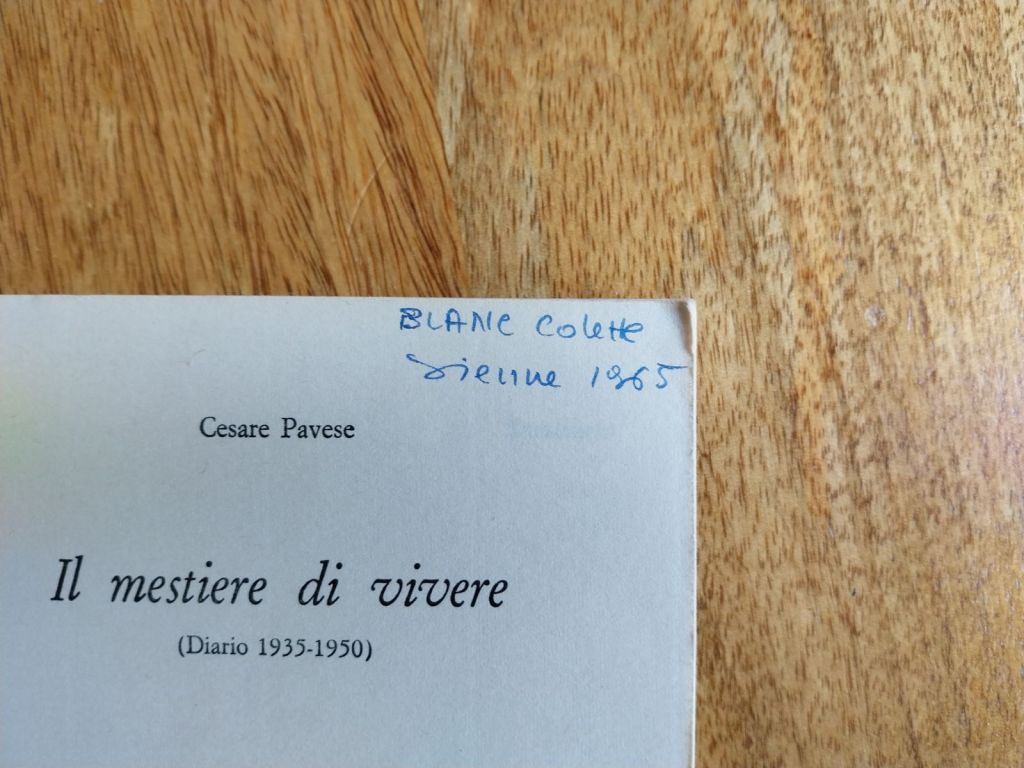
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.