Il est neuf heures vingt-neuf, ce matin, quand le téléphone sonne interrompant ma pénible relecture de l’article de Walter Benjamin sur l’œuvre d’art. Mon frère est à l’appareil pour évoquer les problèmes que pose l’état de santé de notre père et les solutions introuvables, ou quasi. Après cela, je ne pourrai plus lire une seule ligne, toute mon attention sera partie ailleurs, loin de l’endroit où je la destinais. J’essaierai encore de me concentrer un peu, mais ce sera en vain. Alors, j’irai courir. « Pénible », ai-je dit à propos de l’article de WB parce que j’ai le sentiment que la prose cahote, hésitant entre analyse esthétique, perspective historique, programme politique, pétition révolutionnaire, et dans le style même se sentent ces secousses liées à l’état de la route cabossée sur laquelle WB chemine tant bien que mal : développements historiques, thèses assénées en italique, anecdotes, micro-nouvelles, presque poèmes en prose — si l’on sait où va l’article (il y a un plan au début), je peine à comprendre les arguments de WB chez qui on sent une grande ambivalence, comme si la masse, la massification pouvait se tourner et se retourner aussi bien dans un sens que dans l’autre : progressiste ou réactionnaire. Mais surtout, que faire de l’alternative face à laquelle il nous laisse in fine, ce choix entre esthétisation de la politique et politisation de l’art ? Fausse alternative, qui plus est, me semble-t-il : « C’est ou bien le fascisme ou bien le communisme, débrouillez-vous avec cela, moi je ne veux plus rien entendre », semble dire son auteur, ce qui, à l’époque où ce texte a été écrit — entre 1935 pour la première version et 1938 pour la quatrième — pouvait se comprendre, mais qui, pour nous qui savons désormais les ravages auxquels la massification a conduits dans tous les camps (les forces constructives que WB évoque la fin de la version française de son article ne s’étant pas montrées moins totalitaires que les doctrines totalitaires auxquelles il les opposait encore), et qui faisons l’expérience de la dissolution des sociétés humaines à laquelle l’uniformisation par la massification conduit (les mêmes produits reproduits à des milliards d’exemplaires et diffusés en même temps partout sur la terre), paraît presque idyllique. Car, la vérité semble être bien plus désespérante que ce qui nous est présenté : il n’y a pas d’issue. Ou, du moins, diront les plus optimistes d’entre nous, nous n’avons pas encore trouvé d’issue. Et, pour l’instant, que nous soyons optimistes ou que nous soyons pessimistes, cela revient rigoureusement au même. L’objection principale que l’on peut adresser, toutefois, à l’espèce de philosophie du désespoir que j’ai formulée hier au soir (et qu’en vérité Jean Lacoste énonce bien mieux que moi dans sa présentation des textes de WB sur Baudelaire (p. 19) : « L’intuition centrale de Benjamin, si l’on peut avoir la témérité de la formuler, semble résider dans cette conviction que l’espérance ne peut venir qu’à celui qui a perdu tout espoir, comme l’étoile filante dans les Affinités électives de Goethe. Il faut donc, dans une lucidité impitoyable, se dépouiller de tout ce qui a pu faire croire au bonheur (l’aura) pour pouvoir espérer un jour le recouvrer. ») est d’ordre biographique : au fond du désespoir, ce que WB a trouvé, ce n’est pas une source d’espoir, mais la noirceur absolue, le suicide, la fin. Ne pas mépriser le biographique : in fine, tout se ramène à cela, une vie. Et chaque vie est exemplaire, quand même ce dont elle serait exemplaire ne serait pas édifiant. Peut-être y a-t-il là une importante distinction à faire : peut-être que chaque existence exemplifie un mode de vie, mais que tous les modes de vie ne sont pas édifiants. Tout se ramène à cela, une vie, et bien sûr, plus qu’à la vie de WB, c’est à celle de mon père que je pense en ce moment, à sa déchéance, laquelle, comme cela est probable, attend tout être qui vieillit, atteint tout être qui vieillit trop. Est-ce que cela peut se dire, vieillir trop ? Je ne sais pas. Mais mon époque, non plus, ne le sait pas, qui ignore toujours comment se comporter face à l’éminence de la mort, et même : l’évidence de la mort, préfère ne pas la voir, et puis ne pas la regarder, et puis abréger les souffrances, pour le confort de tout le monde. Tout se ramène à cela, une vie, et bien sûr, c’est à ma vie que je pense, à l’avenir qui m’attend. On pourrait dire : une vie, c’est ce qui est attendu et non pas donné, mais la mort n’est-ce pas le toujours déjà donné de la vie ? Qu’il est en pure perte d’attendre parce qu’elle viendra toujours à temps ; — le temps, c’est la mort. Avant de mourir, ma mère avait écrit une lettre à mon père dans laquelle elle lui disait qu’elle n’attendait plus que la vieillesse. Combien de temps avant de mourir avait-elle adressé cette lettre à mon père ? Je ne le sais pas. Je ne peux pas la relire pour le savoir. La lettre, je l’ai remise dans le tiroir où je l’avais trouvée et où je n’aurais pas dû la chercher. Peut-être y est-elle encore. Je l’ignore. S’il m’est permis d’en avoir l’occasion, je chercherai cette lettre la prochaine fois que j’irai à Marseille. Mais, depuis cette lettre, j’ai toujours eu la conviction que c’est de ne plus attendre que la vieillesse qui l’avait tuée.
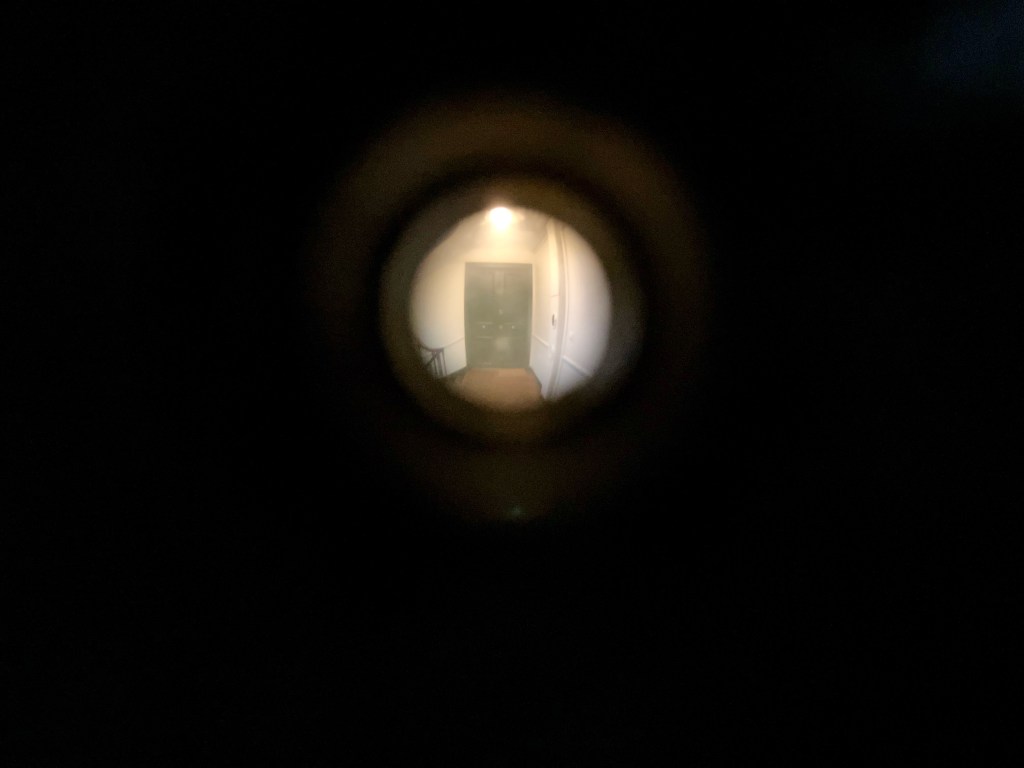
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.