4×10=40. C’est le nombre de pompes que je fais, en début de soirée, pour tâcher de contrôler la nervosité qui m’envahit. Ensuite, je vais préparer la part du dîner qu’il me revient de cuisiner. Je ne sais pas si cet exercice de diversion (les pompes) fonctionne, mais c’est toujours cela de fait. À quoi bon ? Je ne sais pas. Cette question est dévastatrice : correctement assénée, il n’est rien qui lui résiste, tout semble vain à sa lumière sombre. Est-ce que je crois en ce genre de “lumière sombre” ? Quelle étrange question. Psychopompes, devrais-je dire. Un des passages qui m’ont fait la plus forte impression dans le texte de Benjamin sur le Paris de Baudelaire au Second Empire est celui où il fait remarquer, en passant, qu’à son époque il fallait encore traverser la Seine en bac (p. 83). Et la poésie noire qui s’en dégage. Alors, l’image de Charon faisant traverser le Styx aux âmes des défunts ne devait pas évoquer un mythe très éloigné de la réalité ordinaire. Et n’est-ce pas ainsi que les mythes cessent d’être crus : quand la réalité ordinaire s’est éloignée d’eux au point qu’ils ne paraissent plus que des histoires anciennes, qui ne dupent que les gens crédules et arriérés ? Ou alors, il faut avoir une imagination particulière et, sous la couche d’incrédulité qui les recouvre désormais, savoir lire la poésie sombre qui les anime, la lumière noire dont ils éclairent le monde. On peut aussi poser différemment la question : À quel mythe un crématorium est-il susceptible de donner naissance ? Quelles croyances communes peuvent-elles bien être partagés par les humains qui, à notre époque, s’adonnent à de telles pratiques funéraires ? Et dans les esprits de quelle sorte d’êtres humains l’idée même d’un four crématoire ne donne-t-elle pas des frissons, des sueurs froides, des fièvres insomniaques ? Probablement les gens avec lesquels il m’est donné de vivre. N’est-ce pas désespérant ? Hier après-midi, Nelly, à qui je confiais mes états d’âme — ceux que je ne confie même pas à ce journal — m’a suggéré d’aller voir quelqu’un, comme on dit, moins les chopompes, c’est-à-dire. Mais cela n’aurait tout simplement aucun sens, lui ai-je répondu, je ne peux pas confier mes pensées à des gens qui ont les goûts de mes contemporains, ils ne pourraient tout simplement pas comprendre. S’ils le pouvaient, cela, je ne l’ai pas dit à Nelly, je n’y pense que maintenant, toujours l’esprit de l’escalier, mais l’essentiel, c’est de ne pas trébucher, s’ils pouvaient me comprendre, ils achèteraient mes livres, ne crois-tu pas ? Moi, en tout cas, je le crois.








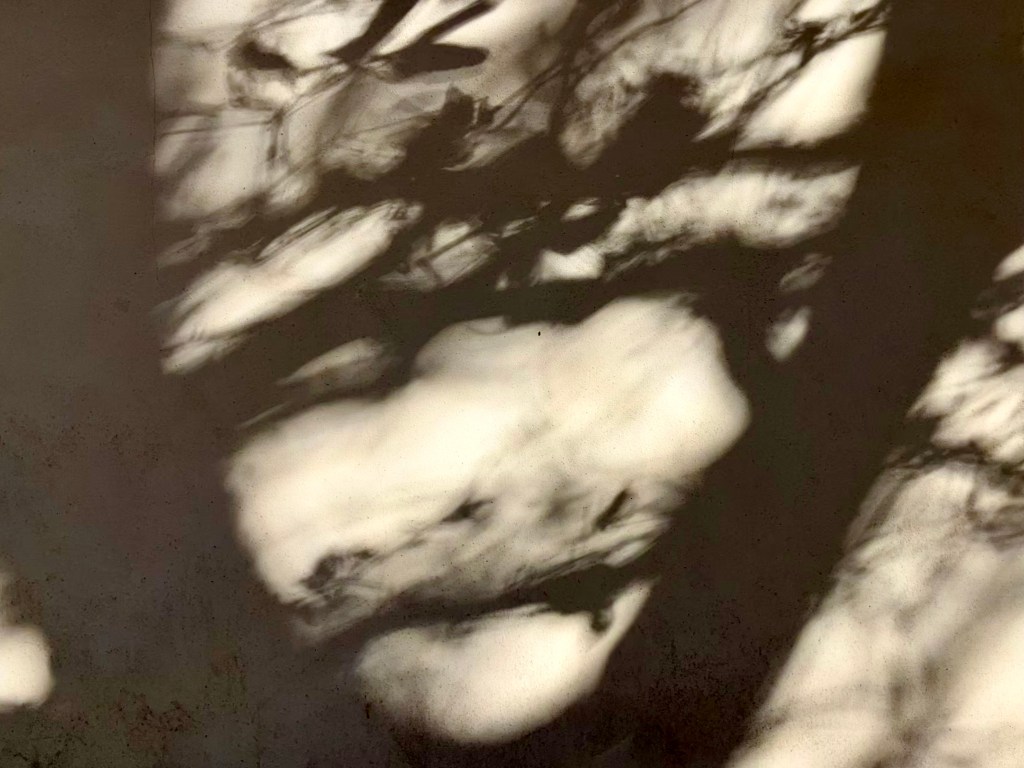

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.