À intervalles irréguliers, les sirènes d’urgence de la modernité viennent interrompre le silence. Et mon sommeil. Il n’est pas encore huit heures du matin, ce samedi de novembre, quand elles me réveillent. La première phrase que j’ai écrite (« À intervalles réguliers, etc. ») me semble étrange, mais elle ne l’est pas : on a tendance à penser que le silence est un manque, une absence de bruits, or, ce n’est pas cela, ce n’est pas quelque chose à proprement parler (au sens où cette table sur laquelle est posée mon ordinateur est une chose), c’est une atmosphère, mais qui a une réalité, néanmoins, que l’on peut entendre, circonscrire, délimiter (Tiens, c’est calme, ce matin, mais pourquoi tout ce vacarme, soudain, pourquoi cette sirène fait-elle tant de bruit alors qu’il n’y a personne dans les rues à cause du froid ?). Il n’y a personne dans les rues, à cause du froid, sans doute, cela, je n’ai pas eu besoin de tirer les rideaux dans le sens de la lumière pour le voir, je sais qu’il n’y a presque personne sur le boulevard, quelques rares véhicules sont garés dans la voie réservée au bus et aux vélos pour livrer les établissements qui servent de la nourriture pour touristes, touristes qui ne sont pas là parce qu’il est encore tôt et qu’il fait froid. Si le titre n’avait pas été privatisé par le Commandant Cousteau, j’eusse aimé écrire un livre ou quelque chose du genre qui se serait intitulé, le Monde du silence, car le silence, si ce n’est pas une chose, ni un objet, ce n’est pas rien non plus, ce n’est pas du rien du tout, c’est tout un monde, oui, en effet, mais peut-être vaut-il mieux que le titre ait été privatisé, car ce n’est pas un bon titre, non, me dis-je après que j’y ai réfléchi quelques instants. Quoi qu’il en soit, j’essaie de ne pas détester le monde. Ou plutôt, je me dis : Vais-je me plaindre ou ne vais-je pas me plaindre ? Finalement, je crois que je décide de ne pas me plaindre. Hier, dans une sorte de perspective adornorkheimerienne, je me suis dit que c’était si facile de détruire, trop facile de détruire, et qu’il faudrait que je n’y cède plus, ou moins du moins, je ne me souviens pas de l’expression exacte que j’ai employée, mais c’est bien l’idée que je me suis formulée. Et ce matin, quand j’ai lu ces phrases — enfin, une en particulier —, ces phrases que j’ai trouvées tellement niaises, tellement clichées, j’ai eu envie de les copier et de m’en moquer, ouvertement, dans un grand ricanement, mais je me suis abstenu, je me suis dit que non, il ne faut pas, et ce n’était pas une affaire morale (Ce n’est pas bien de se moquer des gens.) ni une histoire de point de vue (Après tout, est-ce que toi aussi tu n’es pas un cliché ambulant ?), mais une question d’orientation de mon énergie vitale, oui, je crois que je puis le dire de la sorte, et tant pis si le dire ainsi rend un son un peu bizarre, un peu excessif, un peu mystique, c’est comme cela que j’ai envie de le dire, c’est comme cela qu’il me semble bon de le dire, donc c’est comme cela que je le dis, c’est une question d’orientation de mon énergie vitale : dans quoi est-ce que j’investis ma vie ? Et il m’a semblé qu’il ne fallait pas l’investir, ou ne pas trop l’investir, en tout cas, dans la destruction, la critique, il y a suffisamment de bruits, déjà, trop de bruits qui détruisent le silence, point n’est besoin d’en rajouter. Et cette abstention, ou cette abstinence, je ne sais pas quel mot choisir, peut-être ne faut-il pas choisir mais insister sur les deux également, il m’a semblé que c’était la bonne attitude à adopter face à la vie, l’interruption, en quelque sorte, à l’inverse de la première phrase, désirable, positive, belle.




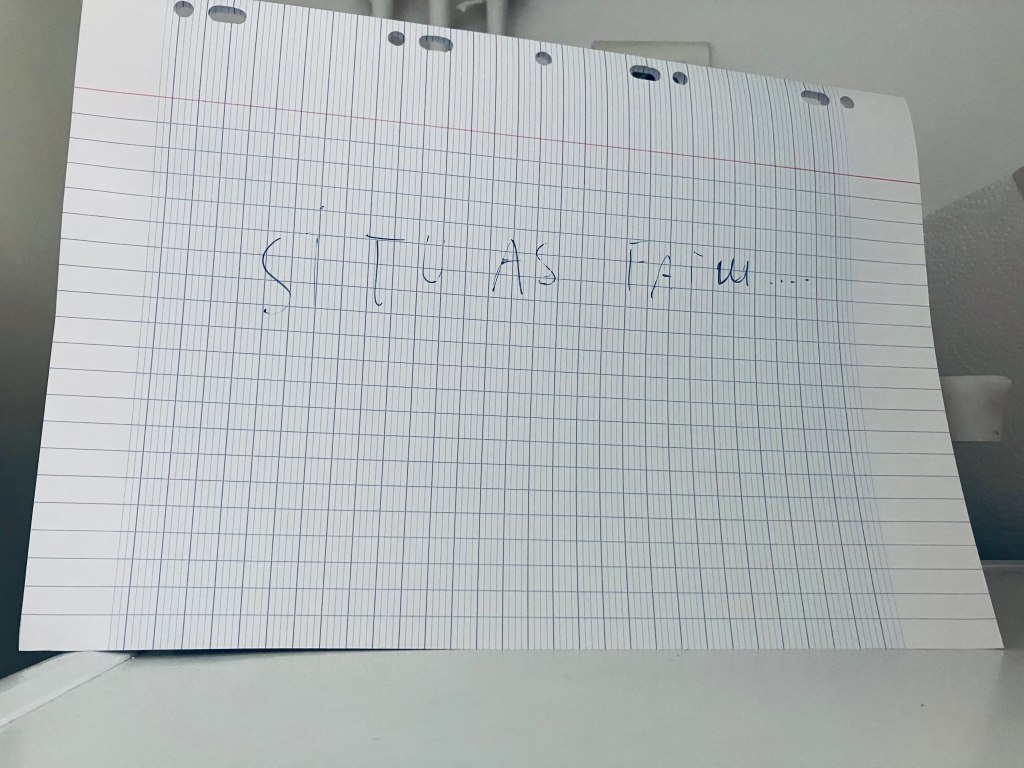

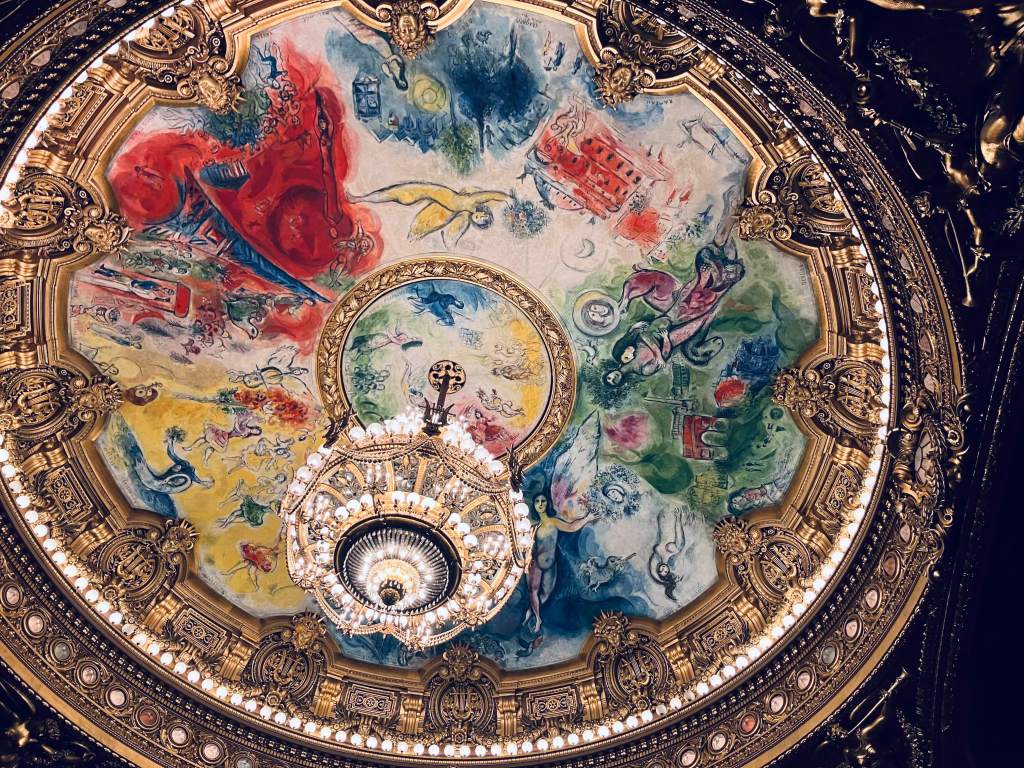



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.