Quand j’ai traversé le Square de l’Abbé Migne, il y avait un mort dans un sac. C’est le chemin que je prends, passant derrière l’entrée des Catacombes, Place Denfert-Rochereau, quand je vais me promener au Parc Montsouris, et là, ce matin-là, contrairement à ce dont j’ai l’habitude, il n’y avait ni touristes ni ivrognes, mais un mort dans un sac. La police avait délimité un petit périmètre de sécurité autour du sac dans lequel se trouvait le corps du mort, interdisant aux passants de passer par là, deux agents en uniforme semblaient être chargés de faire respecter l’interdiction de passer cependant qu’un officier en civil, une femme vêtue d’un blouson aux armes de la Police Nationale, était occupé à remplir divers documents administratifs relatifs, c’est ce que j’ai supposé, au drame qui venait d’avoir lieu. Y avait-il eu un drame ? Cela, à proprement parler, j’eus été bien en peine de le dire, à moins de penser que, quand même toute mort serait dans la nature, toute mort est un drame, comme je ne suis pas loin de le penser moi-même, je ne pouvais que le supposer, à en juger par ce que je voyais, ce cordon de sécurité, ces agents affairés, ce sac blanc dans lequel une forme que j’estimais être la forme d’un être humain gisait à terre. Immédiatement, comme par une sorte d’intention réflexe, j’ai voulu prendre la photographie de ce que je voyais, mais j’ai hésité et, finalement, je ne l’ai pas fait. Je n’y ai plus songé pendant mon tour autour du Parc Montsouris, c’est seulement en revenant sur les lieux du crime, si je puis m’exprimer ainsi, que j’ai pensé de nouveau à ce sac dans lequel se trouvait le cadavre d’un être humain, et alors, bien maladroitement, cette fois, j’ai pris la scène en photographie. Il ne restait plus qu’un agent en uniforme pour garder le périmètre, attendant sans doute le véhicule qui viendrait enlever le corps qui se trouvait toujours là, lequel m’a vu prendre la photographie, il faut dire que, dans mon coupe-vent orange vif, je n’étais pas des plus discrètement vêtus pour pareille mission d’espionnage, mais je n’avais pas prévu les événements qui allaient venir, j’ai vu qu’il m’avait vu prendre la photographie et, voyant qu’il m’avait vu prendre la photographie, j’ai songé un instant aller à sa rencontre pour lui expliquer que je n’étais pas une sorte de badaud pervers, un voyeur que la vue de la mort excite, mais un écrivain, et que si je venais de prendre à l’instant cette photographie, une photographie ratée probablement, d’ailleurs, c’était à titre de document pour le journal que je tiens et dans lequel, venant de le voir, j’avais décidé de consigner ce que j’avais vu, ce matin du vingt-et-un octobre deux mille vingt-trois, un samedi, passant comme j’en ai l’habitude lorsque je vais me promener au parc Montsouris par le Square de l’Abbé Migne, derrière les Catacombes, Place Denfert-Rochereau, à Paris. Mais je ne l’ai pas fait, pas plus que je ne me suis enquis auprès de lui pour lui demander ce qu’il s’était passé, après tout, me suis-je dit, en effet, après tout, je ne suis pas de la police. Je me suis contenté de prendre bien maladroitement ma photographie et de continuer mon chemin, un peu mal à l’aise, je dois l’avouer, d’avoir été surpris par un agent de police en train de documenter la mort d’un être humain dont j’ignorais tout. Et dont je ne saurais sans doute jamais rien. Une fois rentré chez moi après mon tour autour du Parc Montsouris, j’ai cherché des informations concernant ce qu’il s’était passé à cet endroit, ce matin-là, mais je n’ai rien trouvé. Déjà passant devant le corps enveloppé dans un sac en plastique blanc d’un être humain, j’avais trouvé bien étonnant que ce phénomène, banal certes, de la mort d’un être humain, mais pas si commun que cela, tout de même, lorsqu’il y a lieu ainsi, à la vue de tous, dans l’espace public, ne suscite que si peu d’intérêt. Peut-être en avait-il suscité plus tôt, avant que le corps ne soit emballé pour être transporté à la morgue, mais de cette éventuelle agitation, peu de temps après, il ne restait déjà plus la moindre trace. Et bientôt, le corps enlevé, le cordon de sécurité dénoué, il ne resterait plus non plus la moindre trace de la mort d’un être humain à cet endroit-là, à ce moment-là, le matin du vingt-et-un octobre deux mille vingt-trois, un samedi, Square de l’Abbé Migne, derrière les Catacombes, Place Denfert-Rochereau, à Paris. Peut-être y aurait-il un article dans la presse locale, un entrefilet, mais ce journal que je tiens mis à part, qui s’en souviendrait ? Faisant diverses recherches de plus en plus larges, jusqu’à taper dans la barre du moteur de recherche ces deux mots tout simplement : « mort paris », je ne trouvai rien. Aucune des informations que je cherchais, du moins, mais d’autres, concernant d’autres morts, ou des menaces, ou ce qui me semblait confiner au n’importe quoi. Et, alors que tout semble désormais se savoir instantanément, partout en même temps à la surface du vaste monde plus si vaste que cela, de fait, en réalité, il y a des trous, des vides, des manques, des failles, des lacunes, des absences, des disparitions, et que sais-je encore ? des blancs, oui blancs comme le sac dans lequel était enveloppé le cadavre de l’être humain que j’avais vu. J’aurais pu vouloir combler ce blanc, m’assigner cette tâche à moi-même, mais ce n’était pas ce que je voulais, je crois, en regardant cette scène, en la prenant en photographie. Mais alors, qu’est-ce que je voulais ? Je ne sais pas. Rien, peut-être. Peut-être tout simplement me tenir en présence des choses telles qu’elles sont, des événements tels qu’ils ont lieu, si grands soient-il, si insignifiants soient-ils, si dramatiques soient-ils, si banals soient-il. Mais, surtout, je me suis demandé ce que c’était, la mort d’un être humain. Et au fond, je crois, que ce n’est pas grand-chose, et même rien, presque. Tout continue dans sa normalité, dans sa banalité. Tout continue dans la normalité, la banalité de tout. Le fait même qu’un cadavre ne reste pas à l’abandon, là où l’être humain mort est tombé mort, mais qu’on vienne s’en occuper, que les secours arrivent, que la police fasse son travail, cela apparient à la vie normale. Et il n’y a pas le moindre doute que ce soit cela, la civilisation, pour une grande part : cette normalisation de toute choses, cette normalisation de la mort même, sa prise en charge, la prise en charge de toutes les existences de la vie à la mort. Et, à de rares exceptions près qu’il importe toutefois de noter, exceptions qui ont trait alors non plus à la nature de la mort mais à son caractère, à son atrocité, par exemple, à son caractère criminel, abject, notamment quand ce qui est visé dans la mise à mort, c’est l’humanité de la personne que l’on met à mort, pour nier l’humanité de qui l’on met à mort, à ces rares mais considérables exceptions près, la mort n’est pas quelque chose d’étranger à la vie, la vie sociale, la vie normale, la vie banale. Pourtant, la mort, quoiqu’elle ne soit pas quelque chose d’exceptionnel en soi, que nous ne la tenions pas pour un scandale, et que nous finissions par l’accepter, voire la désirer, que nous mettions des êtres à mort ou que nous souhaitions en finir avec la vie, proprement, cliniquement, sans drame ni tragédie, en banalisant à l’extrême la mort, n’est-ce pas la déshumaniser, et déshumaniser l’être humain mort ? À rendre la mort acceptable, n’est-ce pas la vie qu’on rend odieuse ? Et la déshumanité que nous formons, les uns sans les autres, laquelle déshumanité ne se soucie de la mort que par des affinités plus ou moins tolérables, par profession ou par la curiosité plus ou moins saine qu’elle suscite, qui peut bien vouloir s’en accommoder ? Ou mieux : qui sont ces déshumains qui s’en accommodent si facilement, si socialement ? Qui sont-ils ? Eh bien, mais personne d’autre que nous, les humains, qui sommes ce que nous sommes, des humains.
-
S'abonner
Abonné
Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.

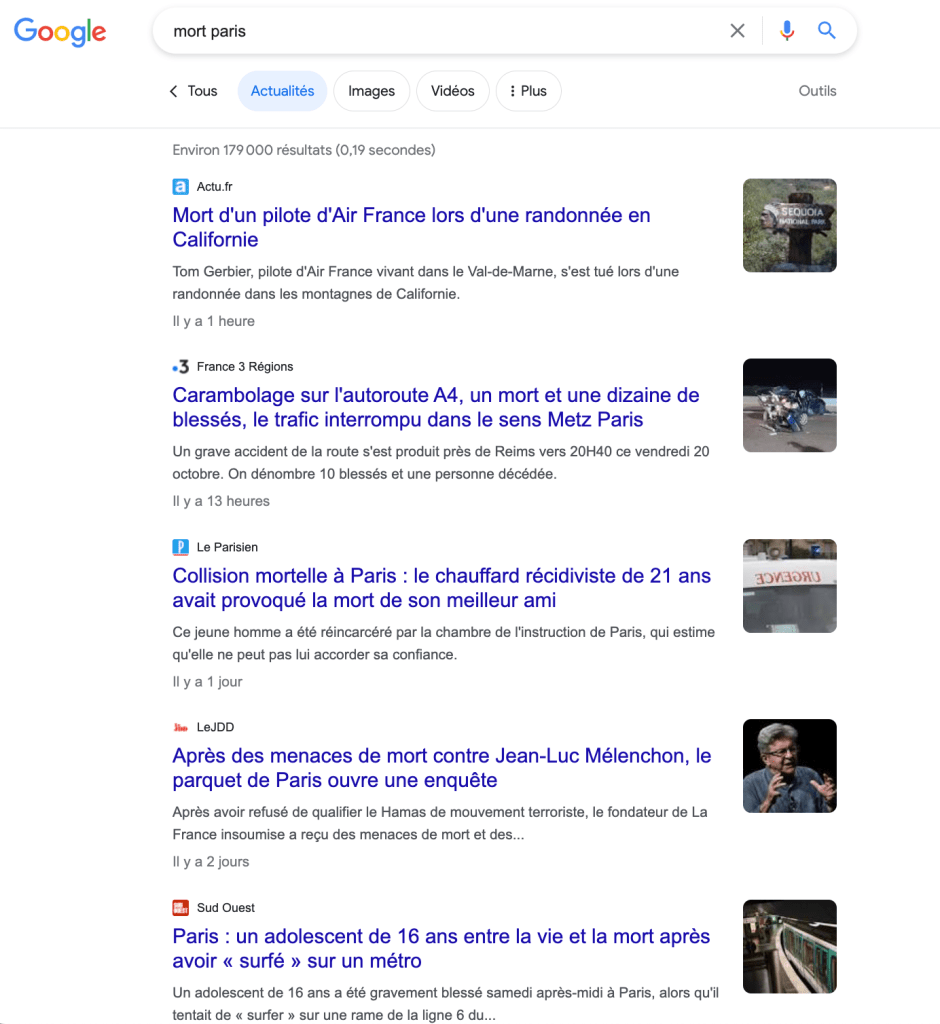
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.