Je n’ai pas quitté Marseille pour Paris ; — j’ai quitté Marseille pour Nelly. Deux fois. Et, si c’était à refaire, comme il arrive parfois qu’on s’imagine pouvoir revivre ce que l’on a vécu, dans une sorte d’expérience de pensée qui n’est pas étrangère à la philosophie de l’éternel retour — fascinante, mais un peu vaine, aussi —, je le referais. Je partirais de nouveau. Encore une fois, non pour Paris, pour Nelly. C’est-à-dire : n’importe où. Il me semble que partir fut quelque chose d’important, que cela a demandé un certain courage (pour quitter, pour changer, pour devenir autre), et que ce que nous avons élaboré avec Nelly, dans cette vie à Paris, nous aurions pu le faire ailleurs, certes, et n’importe où, je le répète, mais non sans partir. De toute façon, l’exil, j’allais dire : c’est dans mes gênes, mais non, ce n’est pas une question de génétique, évidemment, c’est absurde, l’exil est dans les gênes de tout être humain, façon de parler, l’être humain est un animal mobile, mais non pas « migrateur », il ne se déplace pas comme les oiseaux, c’est absurde, comme l’est de façon générale le terme de « migrations » appliqué aux mouvements de l’humanité (migration, migrant, émigré, immigré, émigrant, immigrant, tout cela est absurde, les gens ne migrent pas, les gens ne se déplacent pas pour se déplacer, ils se déplacent pour s’installer, ils ne partent pas pour partir, ils partent pour rester), parce qu’il sait aussi se faire sédentaire (ce que, de facto, nous sommes devenus, peut-être par erreur, peut-être que non), non, je dois dire : c’est dans mon histoire (O barbara furtuna sorte ingrata, etc.). Pourtant, Marseille me manque, — physiquement. Je sais tout le mal que j’ai pensé de cette ville, tout le mal que j’ai pu écrire à son sujet (on peut chercher les passages ici, je ne dissimule rien), au sujet de ses habitants, de certains de leurs modes de vie, et tant de choses dans cet esprit-là, et tout ce que j’ai fui la deuxième fois que je suis parti (non la ville, des gens que je puis nommer un à un, mais je ne le ferai pas, cela ne servirait à rien). Rien de tout cela, je ne le renie, tant s’en faut, c’est à la mesure de ce que m’évoque Marseille, quand j’y suis, et quand je n’y suis pas. Ce matin, avec Sxxxxxxx xxxx, nous échangeons quelques propos au sujet de ces articles, livres, et autres, peut-être, je ne sais pas, qui paraissent ces derniers jours à propos de Marseille, les uns se plaignant que Marseille ne soit pas assez accueillante, les autres proclamant qu’elle n’a pas à l’être, et au sujet desquels je ne sais que penser tant il me semble que tout cela est frappé d’un profond manque de réflexion, j’allais dire : de profondeur, mais le pléonasme, je préfère l’éviter. Ce que j’écris à Sxxxxxxx, je le pense : la beauté de Marseille, comme son climat, comme son site, n’est pas douce, la beauté de Marseille est violente, et ne peut que déclencher des réactions à la mesure de cette violence. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas de paix possible à Marseille, je ne crois pas que ce soit vrai, au contraire, je crois qu’une véritable paix peut (et devrait) s’inventer à partir de ce lieu, à la fois infime et grand comme l’histoire, j’entends : à partir de la Méditerranée, mais je préfère éviter de faire des généralités (ce à quoi, malheureusement, les échanges par livres et articles interposés que je mentionnais à l’instant n’échappent pas, d’où l’impression d’inanité qu’ils dégagent ; de fait, je n’arrive pas à les lire, je me dis : Mais c’est illisible), alors je dirai ceci : j’aime Marseille comme je la hais, — passionnément. En tout cas, c’est ce que la ville provoque en moi. Sentiments que Paris n’a jamais produits et ne produira peut-être jamais. Je peux trouver beaux certains endroits de Paris (la semaine dernière, courant là, je pensais avec tendresse aux quatre saisons du Jardin du Luxembourg), mais en profondeur, la ville ne me fait pas grand-chose. Je sais que c’est ici, en France, que l’histoire se fait, mais quand j’y réfléchis, j’ai le sentiment que cette histoire ne me concerne pas vraiment (c’est une erreur sans doute, je suis aussi français), en tout cas moins que l’histoire qui se tourne vers le sud, vers la mer, la Méditerranée, et tout ce qu’elle ouvre dans le monde aussi bien que dans l’imaginaire, — l’ouverture à tous courants, qui me semble si nécessaire, si vitale. Là, me dis-je, on peut voyager. Et mieux que migrateurs, ne sommes-nous pas des animaux voyageurs ?




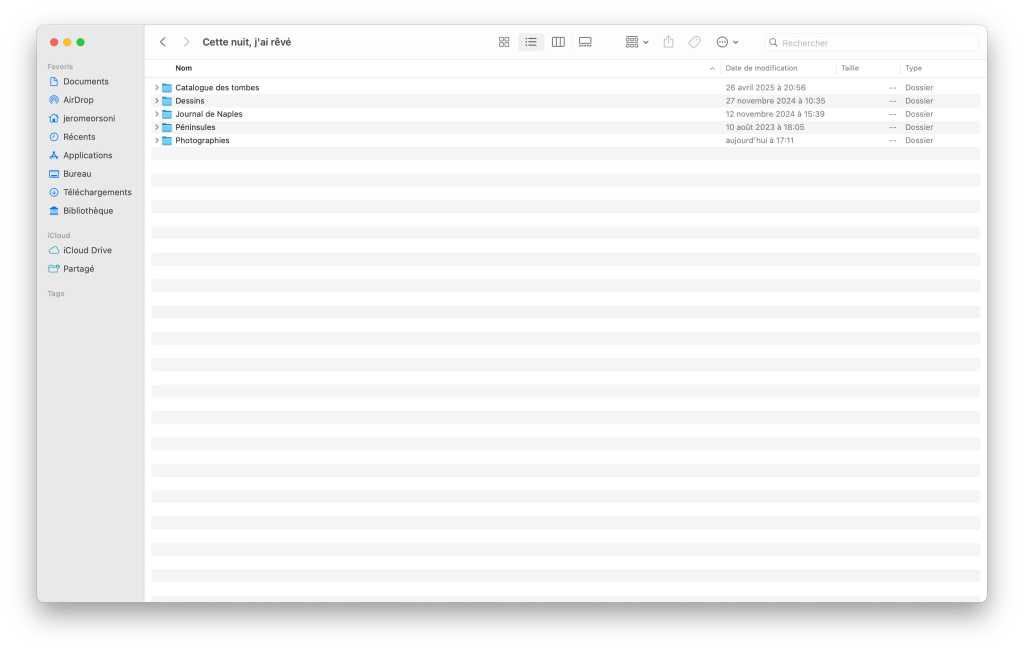


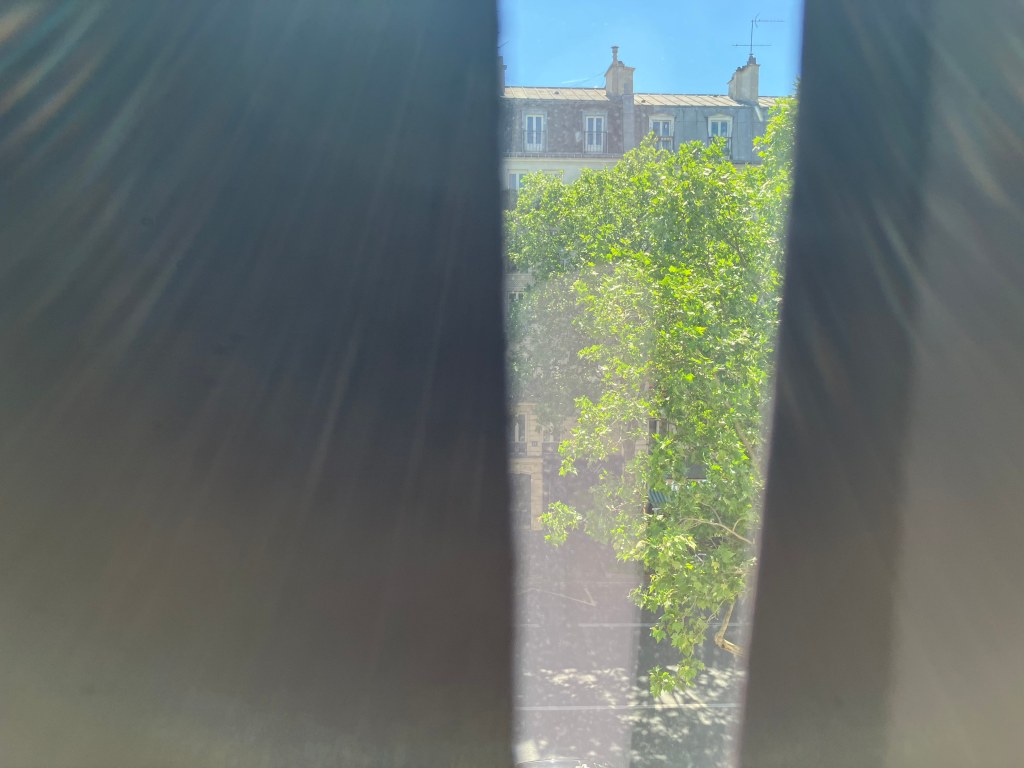


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.