Ce n’est pas parce que j’ai envie de casser — et pas de déconstruire, comme on dit depuis que Derrida a mis un doigt dans le con de Heidegger, non de casser —, ce n’est pas parce que j’ai envie de casser quelque chose (n’importe quoi) qu’il faut que je casse quelque chose (n’importe quoi). Il faut que je bâtisse ma maison. Et ce n’est presque pas une métaphore. Je peux m’époumoner (en mon for intérieur car, dans la réalité, je ne parle à personne ou presque), crier que les gens ne comprennent pas, ne comprennent rien, ne me comprennent pas, ne comprennent jamais que ce qu’ils veulent bien comprendre, et non ce qu’il faudrait qu’ils comprissent, en vérité, qu’est-ce que cela me fait ? J’ai échoué en tout ou j’ai tout réussi, je ne sais pas. Je me sens énervé aujourd’hui, contrarié par tout et n’importe quoi, et cela me déplaît, à moins que ce ne soit l’indice qu’il faut que je fasse quelque chose, que je bâtisse ma maison. C’est étrange comme les fils de mes pensées se croisent sans pour autant former de ces nœuds nés de malencontreux emmêlements, se superposent plutôt les uns au-dessus des autres, et le dessus est une question de point de vue, si on en change, le dessus devient dessous, le dessous, dessus, tout est sens dessous dessus. Les deux textes principaux auxquels je pense en ce moment : loin de Thèbes et — comment s’appelle-t-il, l’autre, déjà ? je crois l’avoir appelé catalogue de tombes, mais ce n’est déjà plus de cela qu’il s’agit, il s’en est allé dans une autre direction, où il s’éloigne et rejoint loin de Thèbes qui, au début, quand j’ai commencé de l’écrire s’appelait tombe. et puis tombé, ou l’inverse — l’autre texte, donc, venant de points éloignés l’un de l’autre me semblent se rencontrer, et ce n’est pas simplement parce que je raconte tout le temps la même chose — ce n’est pas vrai que je raconte la même chose —, c’est qu’il existe différentes manières de parvenir au même endroit d’où l’on s’en ira pour aller ailleurs. D’ailleurs (mais moi mis à part, personne n’a jamais fait cette expérience et peut-être que personne ne la fera jamais), ces textes, on pourrait presque dire qu’ils ne sont pas écrits par la même personne tant ils se ressemblent peu. Et pourtant, d’un autre point de vue, comme je viens de le dire, ils se ressemblent beaucoup. Si j’avais un éditeur pour les publier, je lui dirais : « Ces deux livres, il faudra les publier ensemble », et je me mettrais à les écrire ensemble, main dans la main, mais je n’ai pas ce genre de luxe. Ce que je reproche souvent aux écrivains, c’est qu’ils écrivent toujours de la même façon, toujours le même livre, que s’y entend toujours le même style, le même ton, la même façon de faire, la même voix, comme on dit. Peut-être que c’est quelque chose que les lecteurs aiment bien, que ce soit toujours la même voix qu’ils entendent, cela les rassure, quand ils ouvrent un livre de tel ou tel écrivain, c’est comme s’ils retrouvaient leurs petites pantoufles, ils mettent leurs petits petons dedans et ils s’y sentent bien, ils sont au chaud, c’est douillet, et puis on leur parle de choses qu’ils ont déjà entendues, qu’ils connaissent déjà, alors, c’est bon, ils peuvent dormir tranquilles, la voix les berce, ils n’ont pas à réfléchir, ils ne craignent plus rien, ils peuvent continuer de dormir. Par exemple, quand je lis les livres de Sebald, j’ai l’impression que c’est toujours la même chose. La même construction, les mêmes thèmes, ou les mêmes obsessions, plutôt, ce qui n’empêche pas qu’il s’y trouve des idées géniales, ou du moins de bonnes idées, mais on n’est jamais dépaysé. C’est un peu comme si, dans la vie, on n’avait qu’une seule humeur. Ce serait insupportable, non ? Les gens qui sont toujours d’humeur égale, comme on dit, sont insupportables : ce sont ou bien des légumes ou bien des excités, et personne n’a envie d’être ou bien un légume ou bien un excité. Comme dans la musique, il y a des mouvements dans la vie, et ce ne sont pas toujours les mêmes. Il faut que les livres soient comme ces mouvements, comme les mouvements de la vie, comme les mouvements de la musique, et que, à l’intérieur des livres, ces mouvements se retrouvent aussi, qu’un livre vive, change, chante, respire, délire, approfondisse, creuse, se terre, s’envole, s’enterre, s’énerve, s’agace, fâche et se fâche, se fasse tendre, se fasse entendre, se taise. Mais peut-être que le public n’aime pas cela. Peut-être que le public aime les choses simples. Les gentilles berceuses. Je n’en sais rien, je n’y connais rien au public, moi. Il paraît, de toute façon, que les gens sont de moins en moins intelligents. Est-ce étonnant ? Je ne le crois pas : ils se préparent à être remplacés par une vie artificielle, tout simplement.





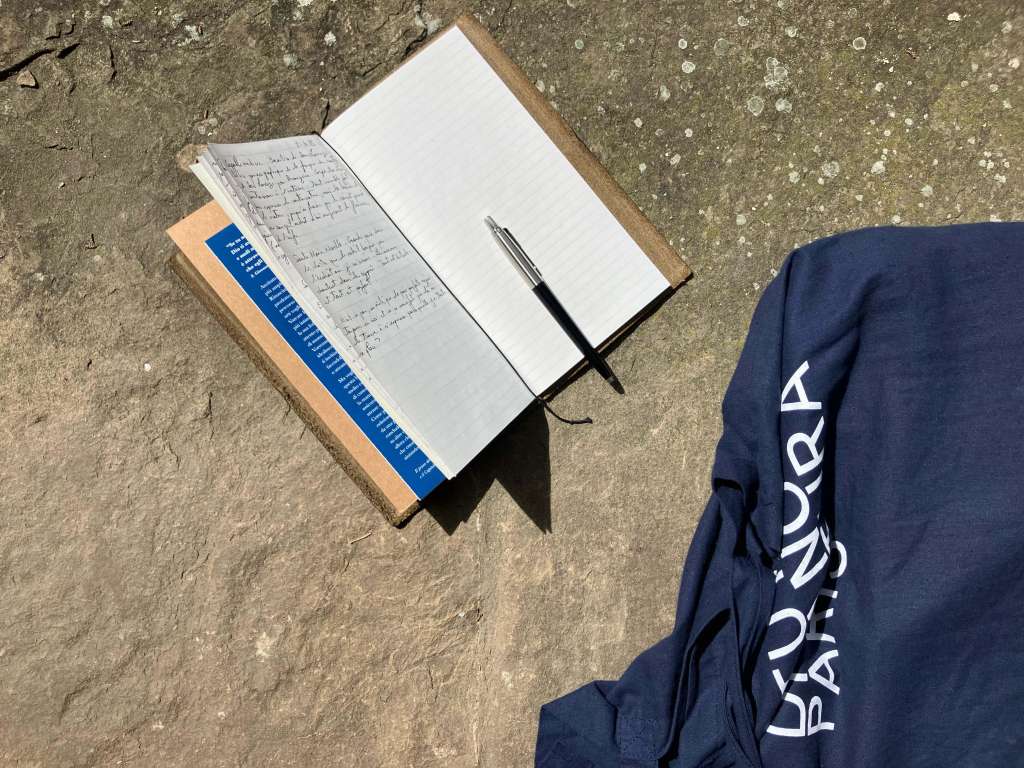




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.