Il fait chaud à Marseille, mais pas trop, et je me sens bien à Marseille, mais pas trop. Les deux « pas trop », toutefois, ne se recoupent pas : ce n’est pas le pas trop du chaud qui implique le pas trop du bien, ni même le fait d’être à Marseille. C’est autre chose. Que voici. À deux reprises depuis que je suis arrivé ici, je me suis senti trahi et humilié. Et c’est un sentiment qui m’est des plus pénibles, cette honte que je ressens quand j’ai l’impression d’être humilié, de ne pas être pris en considération, d’être traité avec le plus considérable des mépris par quelqu’un qui ne fait aucun cas de moi, me traite comme quantité négligeable. Là-contre, et ceci renforce le sentiment que je viens de décrire, là-contre, je ne puis rien faire, je me sens bêtement impuissant, je ne peux que goûter l’amertume de ma misère ; et puis, me venger ne changerait rien, de toute façon, je ne me sentirais pas mieux. Il n’y a absolument rien que je puisse faire dans cette direction, il faut que j’agisse dans une autre direction, et c’est ce que j’essaie de m’employer à faire. Mais pourquoi faut-il toujours être humilié, se sentir humilié, pourquoi toujours cette honte qui nous détruit ? Le troisième livre du Gai savoir s’achève sur une série de huit questions dont suivent les trois dernières : « 273. Qui nommes-tu mauvais ? — Celui qui veut toujours faire honte. 274. Qu’y a-t-il pour toi de plus humain ? — Épargner la honte à quelqu’un. 275. Quel est le sceau de la liberté acquise ? — Ne plus avoir honte de soi-même. » C’est dans cette liste de questions que se trouve pour la première fois chez Nietzsche l’impératif de devenir qui l’on est qu’il a emprunté à Pindare et qui fera le sous-titre d’Ecce homo, lequel impératif m’aura inspiré des sentiments contrastés : une admiration enthousiaste (un peu comme sous l’effet d’une révélation), puis un rejet logique (si l’on devient qui l’on est, on ne devient, il faut devenir qui l’on n’est pas), et enfin quelque chose de plus mesuré, compréhension mêlée de suspicion, sur le thème : mais n’est-ce pas un peu trop facile, n’est-ce pas un peu trop commode que de s’imaginer s’en tirer de la sorte ? Sommes-nous seulement (quelqu’un, quelque chose, une personne, etc.) ? N’est-ce pas déjà trop supposer ? Or, s’interrogeant de la sorte dans le contexte de la série de questions qui closent le troisième livre du Gai savoir, l’impératif s’éclaire d’un jour nouveau : il faut devenir sans honte, sans nulle honte causée ni nulle honte subie. Le est que l’on devient n’est pas un être, c’est une libération (der erreichten Freiheit, la liberté atteinte). De cela, est-il besoin de dire que je me sens infiniment loin, que plus j’avance et plus j’ai l’impression de m’en éloigner ?
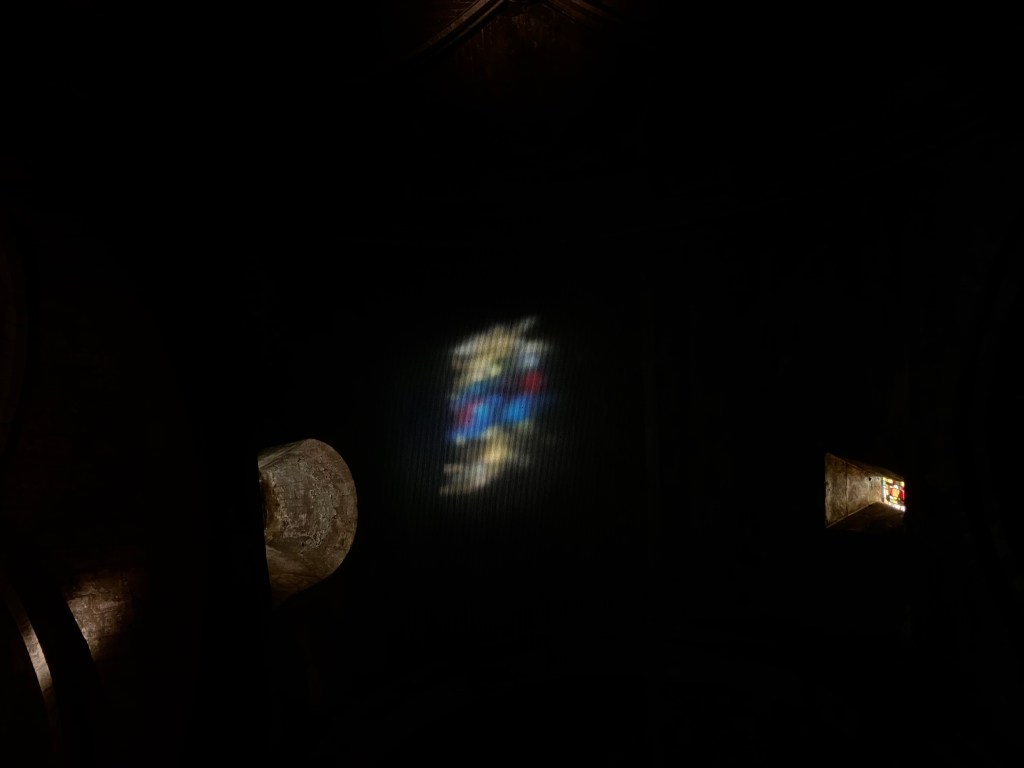









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.