Brouhaha. — Ce mot me plaît, et l’étymologie qu’en donne le Trésor de la langue française ne fait qu’accroître ce plaisir, je cite: « ÉTYMOL. ET HIST. − 1. 1548 loc. interjective attribuée au diable, destinée à inspirer la terreur (Farce du Savetier, Ancien Théâtre fr., p. p. M. Viollet le Duc 1854, t. 2, p. 137 : Audin : Je prie à Dieu que le grant dyable Te puisse emporter. Le curé, habillé en dyable : Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha. Audin : Jésus, Notre-Dame ! Le Grant dyable emporte ma femme); 2. 1552 subst. (Ch. Estienne, Dictionarium latinogallicum, s.v. tragoedias agere : faire d’ung neant une grande chose, faire ung grand brouhaha pour un rien) ; 1659 « bruit confus marquant l’approbation des spectateurs dans un théâtre » (Molière, Les Précieuses ridicules, éd. du Seuil, 1962, p. 107, scène IX) ; qualifié de “fam.” par l’Ac. 1718-1932 ; av. 1755 « bruit confus » (Saint-Simon, Mémoires, 64, 65 dans Littré : Ce brouhaha de passer dans la pièce d’audience était toujours assez long). Orig. discutée. L’hyp. la plus probable semble être celle d’une altération onomatopéique de l’hébr. (FEW t. 20, p. 24 ; EWFS2 ; Bl.-W.5 ; Lok., no256 ; REW68, no968) bārūkh habbā « béni soit celui qui vient » (formule complète : bārūkh habbā beshēm adonāï « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », Psaume 118, 26, par laquelle les Lévites accueillaient le peuple se dirigeant vers le Temple) : ces paroles, fréquemment empl. dans les prières juives, auraient été déformées par ceux qui ignorent l’hébreu. Pour la formule attribuée au diable et le sens péj., cf. sabbat « jour de repos des juifs » et « assemblée nocturne de sorciers et de sorcières ». L’hyp. d’une orig. purement onomatopéique est soutenue par Mén. 1750, DG, Dauzat 1968, Sain. Sources t. 3, pp. 150-151 ; le texte de Rabelais cité par ce dernier (Le Quart Livre, 1552, XIII, 61-67, éd. R. Marichal, 1947, p. 84 : tous sortirent on chemin au davant de luy […] sonnans de leurs cymbales et hurlans en diable : « Hho, hho, hho, hho, brrrourrrourrrs, rrrourrrs, rrrourrrs. Hou, hou, hou. Hho, hho, hho. Frere Estienne, faisons nous pas bien les Diables? ») pourrait n’être qu’une autre adaptation burlesque du psaume 118 (dans les deux cas il s’agit d’une formule d’accueil) par imitation de la Farce du Savetier. » Mais la chose, la chose qui brouhahate ou qui fait que ça brouhahate, que nenni. Pourtant, elle est partout. À croire que le diable — que, comme le mal, nous avons chassé de nos esprits — nous rentre par les oreilles pour se venger de nous, de ne plus croire en lui. Et, si les voies que j’essaie de suivre — « explorer » serait un bien trop grand mot, mais c’est peut-être l’idée, oui — semblent ne me conduire nulle part, elles valent mieux que le brouhaha qui règne, s’impose de toute part comme la seule forme d’expression dont nous sommes capables : du bruit, toujours plus de bruit, et en vain. Je cherche quelque chose que je n’ai pas encore trouvé, et peut-être que cela n’existe pas, ou bien peut-être que je ne cherche pas comme il faut, pas où il faut, pas avec la détermination qu’il faut, peut-être que je cherche mal, peut-être que je pense mal, peut-être que je vis mal. Comment savoir, sinon en continuant de chercher ? Ma conclusion au sujet de la démence, hier, bien sûr, était largement autobiographique, mais elle ne s’y limite pas, toutefois. Et l’évidence de son impersonnalité me semble aller de soi. Mais cette impersonnalité ne doit pas signifier ou être comprise comme une dépersonnalisation. Il faut contourner l’écueil de l’universalisme — qui n’est jamais personne — par la spécificité, la singularité, le personnel, l’individu, le propre d’une géographie, le caractère unique d’un territoire donné, qui ne sont ni des formes égoïstes (l’individu en tant que tel n’est pas recroquevillé sur son narcissisme, les yeux rivés sur l’image de soi qu’il prend, le selfie, littéralement le petit moi, il est tous sens ouverts) ni des zones verrouillées (la terre natale, le pays, le chez-soi n’est pas le lieu de la communauté close par exclusion de qui n’en est pas, n’en vient pas, que ce soit le clan, la race, l’ethnie, la gated community), mais des possibilités d’être soi, ici ou là, de traverser et d’être traversé par le monde, l’univers. La géolocalisation n’est pas le repli sur soi, pas plus que dire je n’enferme dans la chambre froide de la conscience de soi, c’est même très exactement la possibilité du contraire : non pas globaliser la présence, mais lui donner le sens d’un lieu, des parfums, des couleurs, des atmosphères, des climats, non pas revendiquer l’absolu de son intimité et de son autobiographique dont le récit est l’accomplissement du moi ni parler pour qui ne peut pas parler (the voice of the voiceless), mais chercher quelque chose à dire, de quoi parler, pour quoi faire, revitaliser l’originalité comme propre du sans-pareil. Ce que, pour ma part, je veux appeler ainsi : le régime méditerranéen.







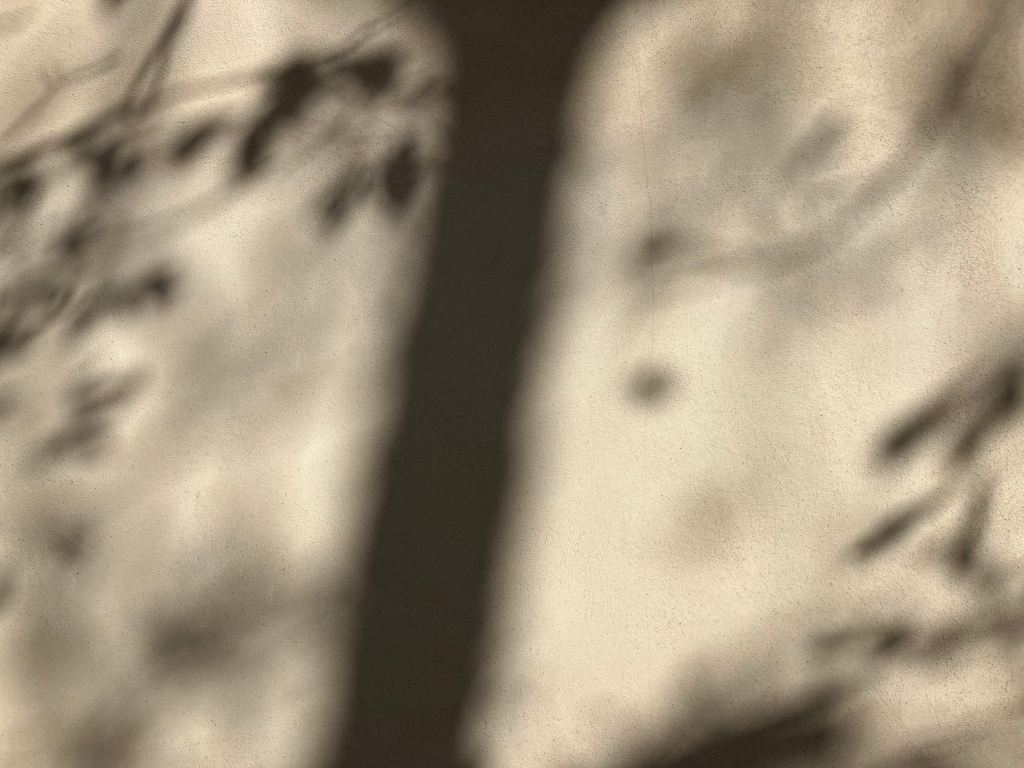


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.